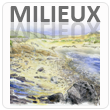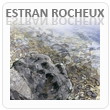Les platiers rocheux à fissures susceptibles d’accueillir des arthropodes continentaux se situent essentiellement de l'étage inférieur médiolittoral à Fucus serratus jusqu’à l’étage supérieur à Pelvétie (Pelvetia caniculata) (selon la classification de Davy de Virville).
Les fissures se forment, évoluent et sont détruites sous l’effet de facteurs mécaniques (gel, vagues, courants) et chimiques (précipitations, eau de mer). Toutes les côtes rocheuses n’offrent ainsi pas le même potentiel d’accueil. Les roches granitiques du Val de Saire ou de la Hague sont apparues au cours de notre inventaire comme étant particulièrement favorables à la formation de fissures nombreuses et profondes.
Ces fissures, plus ou moins comblées de sédiments, offrent à une faune d’arthropodes continentaux, à respiration aérienne, un refuge face à une immersion quotidienne. L’expression d’un cortège d’arthropodes continentaux diversifié sera lié à la largeur et à la profondeur des fissures ainsi qu’à leur exposition. Les larges fissures peu profondes des zones en mode battu apparaissent ainsi comme peu favorables. L’étage moyen du médiolittoral en mode semi-battu semble être quant à lui le plus propice à la formation de fissures profondes et nombreuses et a été particulièrement étudié.
 Selon Richoux (1972), les fissures intertidales offrent aux arthropodes les conditions microclimatiques stables qui sont indispensables à leur maintien : obscurité totale, atmosphère très voisine de la saturation en eau et température variant régulièrement toute l’année. Les invertébrés qui y vivent sont tous lucifuges et thigmotropes. Ils sont très sensibles, pour la plupart, aux variations hygrométriques, même faibles.
Selon Richoux (1972), les fissures intertidales offrent aux arthropodes les conditions microclimatiques stables qui sont indispensables à leur maintien : obscurité totale, atmosphère très voisine de la saturation en eau et température variant régulièrement toute l’année. Les invertébrés qui y vivent sont tous lucifuges et thigmotropes. Ils sont très sensibles, pour la plupart, aux variations hygrométriques, même faibles.
Le mode de vie de ces arthropodes intertidaux en milieux rocheux est, selon Baudoin (1952), très comparable à celui des endogés continentaux qui retrouvent des conditions microclimatiques similaires dans les grottes et les cavités. Les principaux représentants sont dépourvus d’ailes et se déplacent donc uniquement en marchant. La base de la chaîne alimentaire est constituée principalement par le plancton et les débris déposés par les flots dans les fissures à chaque immersion. Les collemboles Anurida se nourriront de ces déchets et des cadavres des organismes filtreurs. Ils constitueront eux-mêmes les proies des arthropodes prédateurs (arachnides, insectes et myriapodes).
 L’inventaire de ce milieu si particulier est destructeur pour le milieu. Il nécessite en effet d’ouvrir à l’aide d’un burin et d’un marteau la fissure, détruisant ainsi le micro-habitat mis à nu.
L’inventaire de ce milieu si particulier est destructeur pour le milieu. Il nécessite en effet d’ouvrir à l’aide d’un burin et d’un marteau la fissure, détruisant ainsi le micro-habitat mis à nu.
A ces espèces s'ajoutent des mouches volant au dessus des rochers, des algues fraîches et des vasques d’eau de mer. Certaines parasitent les balanes.
 Plus haut, l’étage supralittoral rocheux à lichens est moins favorable aux fissures. Il offre toutefois un habitat très spécifique. Les vasques (ou rock-pools) sont de petites collections d’eau de mer exceptionnellement recouvertes par la mer, qui présentent des variations importantes de salinité et de température. Malgré ces conditions de vie extrêmes, cet habitat est le lieu de vie privilégié de petits coléoptères aquatiques. On peut les observer se déplaçant sur le fond ou les parois mais ils volent très bien et peuvent coloniser de nouvelles flaques.
Plus haut, l’étage supralittoral rocheux à lichens est moins favorable aux fissures. Il offre toutefois un habitat très spécifique. Les vasques (ou rock-pools) sont de petites collections d’eau de mer exceptionnellement recouvertes par la mer, qui présentent des variations importantes de salinité et de température. Malgré ces conditions de vie extrêmes, cet habitat est le lieu de vie privilégié de petits coléoptères aquatiques. On peut les observer se déplaçant sur le fond ou les parois mais ils volent très bien et peuvent coloniser de nouvelles flaques.